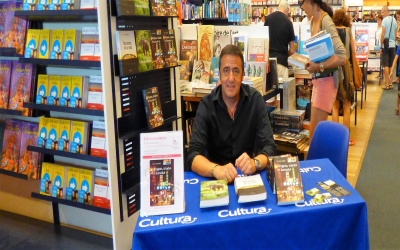"L'oeuvre" d'E Zola
"L'oeuvre" de Émile Zola.
"Il en arrivait à déclamer contre le travail au Louvre, il se serait, disait-il, coupé le poignet, plutôt que d'y retourner gâter son oeil à une de ces copies, qui encrassent pour toujours la vision du monde où l'on vit. Est-ce que, en art, il y avait autre chose que de donner ce qu'on a dans le ventre ?"
Comme d'habitude chez Zola, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Nulle longue introduction qui décrit le lieu de l'action où son époque, nous entrons immédiatement dans le vif du sujet. Nous savons que nous sommes à Paris, que c'est l'époque où l'on se déplaçait en fiacre et où l'on exposait au Salon (soit le milieu du 19è siècle environ), et nous suivons Claude Lantier, un homme qui rentre chez lui par un soir d'été particulièrement orageux. Il tombe alors sur une personne éplorée, réfugiée au pas de sa porte. C'est une fille qui devait se rendre à Passy mais qui s'est égarée dans une capitale qu'elle ne connaît pas. Qui est cette personne, et que va-t-il se passer ? En moins de dix pages, on est pris par le suspense et l'action.
"À pleine main, il avait pris un couteau à palette très large ; et, d'un seul coup, lentement, profondément, il gratta la tête et la gorge de la femme. Ce fut un meurtre véritable, un écrasement : tout disparut dans une bouillie fangeuse. Alors, à côté du monsieur au veston vigoureux, parmi les verdures éclatantes où se jouaient les deux petites lutteuses si claires, il n'y eut plus, de cette femme nue, sans poitrine et sans tête, qu'un tronçon mutilé, qu'une tache vague de cadavre, une chaire évaporée et morte."
Niveau peinture, c'est un peu l'ode à Courbet et Delacroix. Un mouvement qui cherche à révolutionner la peinture en cours à cette période. Mais la fameuse oeuvre de Lantier, qu'il veut présenter au Salon, saura-t-elle convaincre ? Malgré l'aide de Christine, ainsi que leur relation naissante et stable, la difficulté sera au rendez-vous.
"Cette fille nue avait son visage, et une révolte la soulevait, comme si elle avait eu son corps, comme si, brutalement, l'on eût déshabillé là toute sa nudité de vierge. Elle était surtout blessée par l'emportement de la peinture, si rude, qu'elle s'en trouvait violentée, la chair meurtrie. Cette peinture, elle ne la comprenait pas, elle la jugeait exécrable..."
Claude, la figure de l'artiste, est pris dans une spirale de productivité incomplète, inachevée, et désolante. Il sombre dans l'éternelle déception. Il entraîne aussi son couple dans l'insatisfaction et la frustration.
Il y a du "Dorian Gray" dans l'histoire du tableau de Claude que nous conte Zola, d'autant que "L'oeuvre" est antérieure au récit de Wilde, et en est donc son précurseur. On y découvre un tableau qui crée la jalousie de Christine, avec un effet de dédoublement et de rajeunissement de sa chair, mais du côté du personnage picturale et non de l'être réel, qui, contrairement au "Portrait de Dorian Gray", et telle une antinomie, va voir ses chairs de femme se gâter. Lorsque Claude retombe dessus, des années après, la scène sera tragique. D'ailleurs "L'oeuvre" est comme une tragédie. Claude ne pourra jamais échapper à l'inéluctable tandis que la réussite le fuira toujours.
"Mais pourquoi ces bêtises, pourquoi autre chose que moi, qui t'aime ?... Tu m'as pris pour modèle, tu as voulu des copies de mon corps. À quoi bon, dis ? est-ce que ces copies me valent ? elles sont affreuses, elles sont sont raides et froides comme des cadavres..."
Lors du mariage, tandis que les hommes ne font que parler d'une sculpture précise de Mahoudeau, la Baigneuse debout, et que Claude rabâche l'histoire de son effondrement, sans porter d'intérêt à sa nouvelle épouse, le lecteur est bouleversé par tant de réalisme psychologique et de souffrance de la part de Christine. Zola écrit là une séquence admirable, marquante et profondément troublante, qui s'étirera jusqu'à l'heure du coucher, alors que leur nuit de noces vire au néant. Le dénouement, parfaitement crédible et surréaliste à la fois, fait froid dans le dos.
Certains passages, on le répète, sont fascinants de morbidité. On imagine aisément la stupeur des lecteurs de l'époque, et encore aujourd'hui, lorsqu'on découvre les conditions de la réalisation de "L'enfant mort". La rapidité d'exécution de cette peinture, et surtout la soudaineté avec laquelle Claude a l'idée de peindre cette toile, sont sidérantes. De s'apercevoir que notre héros peint le soir même de la mort de l'enfant s'avère effroyable et malsain au possible. On n'écrit pas des choses aussi modernes et novatrices dans la littérature d'aujourd'hui ; c'est un coup de maître à n'en pas douter. Mais les lecteurs sensibles grinceront forcément des dents, à moins que, d'effroi, cela ne leur soulève carrément le coeur. Pourtant, tout est dit simplement, sans effet exacerbé, et presque calmement, ce qui nous oblige à le voir comme quelque chose de quotidien, et ça déstabilise.
À découvrir !
R.P.
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 13 autres membres